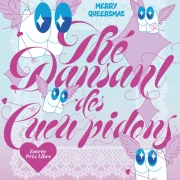Le bruit du gravier

«Seul un grand acteur est capable de faire rire avec un tel poids tragique»: lorsqu’il
«Seul un grand acteur est capable de faire rire avec un tel poids tragique»: lorsqu’il parle de cinéma et de l’inoubliable interprétation de Michel Serrault dans La Cage aux Folles, Nicolas Maury s’enflamme et renchérit: «La tragédie d’être au monde, c’est ce que j’appelle aussi le désastre. C’est sublime.» Cette tragédie latente de l’existence, ce drame absurde du quotidien, le cinéma les amplifie. Tout prend une dimension vertigineuse sur grand écran et marque notre inconscient de façon indélébile. Tiens, chaque fois que je marche sur des graviers, le crissement de mes pas me rappelle à l’image d’une Citroën DS. Je me délecte à imaginer la voiture au design le plus chic arriver devant un manoir français pour y déposer Alain Delon. Il descend, impeccable sous son chapeau Borsalino dévoilant savamment son regard félin. À son tour, il fait craqueter les graviers sous ses mocassins en cuir de style italien. Ai-je vu cette scène au cinéma ou l’ai-je tout simplement inventée? Je ne m’en souviens pas et peu importe. Ce qui compte, c’est la dimension cinématographique qu’elle représente à mes yeux.
«J’te referai plus l’plan d’la star
Qui a toujours ses coups de cafard»
En écoutant Nicolas Maury, toutes nos références communes me reviennent. Mon obsession pour Isabelle Adjani dans Subway de Luc Besson et la fameuse scène du dîner avec sa coupe iroquoise. La même Adjani qui me faisait chavirer dans le clip de Pull Marine, réalisé lui aussi par Luc Besson. Je repense à Isabelle Huppert, son karma chameleon et ses sourcils parfois sévères. Surtout, je me souviens de cette fameuse fois où nous partions à Paris avec ma mère et des ami·e·s, 37°2 le matin était encore à l’affiche. À 16 ans, je brûlais de voir le film, alors j’avais commencé par lire le roman de Philippe Djian. J’étais (déjà!) tombé raide dingue de Béatrice Dalle.
«Tiens, la voilà ta Béatrice Dalle!»
Pendant le trajet en TGV je serinais ma mère: «tu penses qu’on va la voir à Paris?» Au bout de cinq fois, la réponse fut: «Ah, mais tu commences à nous saouler avec ta Béatrice Dalle, hein!» Arrivé·e·s à Paris, les bagages déposés à l’hôtel, nous étions sorti·e·s nous balader. Le nez en l’air, j’admirais les immeubles haussmanniens. Tout-à-coup, bam! «Tiens, la voilà ta Béatrice Dalle!»: ma mère l’avait repérée. Cheveux noirs bombés sur le devant et eyeliner de féline, elle était sagement plantée là dans la rue, en train de tourner une scène. Choc sismique! Ces images filmiques font intrinsèquement partie de qui je suis aujourd’hui. Sans la découverte des productions de John Waters, sans le regard starifiant que portait Andy Warhol sur les célébrités du New York des années 70 et 80, mon regard serait aujourd’hui moins affûté, préparé, éduqué pour assimiler l’évolution monstre de la société.