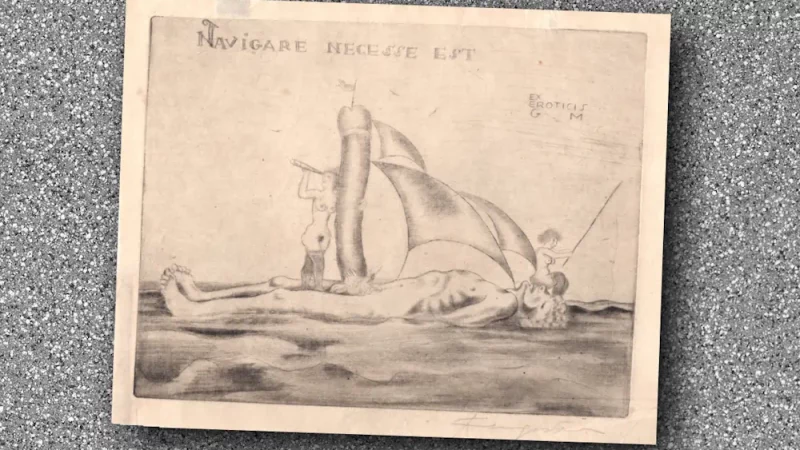«Les luttes d’aujourd’hui manquent d’humour»

La réalisatrice Carole Roussopoulos est l'auteure de nombreux documentaires qui ont marqué l’histoire du MLF. 360° l’a rencontrée chez elle, à Sion, pour évoquer les luttes d’hier et celles d’aujourd’hui.
Les premiers pas du MLF, ceux du Front homosexuel d’action révolutionnaire et des Gouines rouges, les débats révolutionnaires dans les cercles universitaires, l’occupation des usines Lip… Caméra vidéo au poing, Carole Roussopoulos, tout juste débarquée à Paris de son Valais natal, a tout filmé des grands moments de la mobilisation féministe post soixante-huitarde. A la clef, aux côtés de Delphine Seyrig, des films qui auront marqué l’histoire du mouvement. Comme «Scum manifesto» et «Maso et Miso vont en vacances» (parodie mythique d’un entretien entre Bernard Pivot et Françoise Giroud, alors considérée comme le suppôt d’un Etat patriarcal), tous deux diffusés dans le cadre d’une soirée spéciale «Carole Roussopoulos» que le festival du film Regard’autres a eu la bonne idée de mettre sur pied.
Plus de trente-cinq ans plus tard, Carole Roussopoulos filme toujours avec la même conviction les femmes qui aujourd’hui se mobilisent. Son dernier film, «Qui a peur des amazones?», produit par l’association lesbienne Lestime, sera également diffusé en première dans le cadre du festival.
– Carole Roussopoulos vous êtes née en Valais, vous y vivez à nouveau après avoir été de tous les combats à Paris. Quel rapport entretenez-vous avec ce canton pas forcément le plus ouvert à la libération des femmes?
– Je suis valaisanne. J’ai habité ici jusqu’à 18–19 ans. Ensuite je suis allée à Lausanne faire des études de Lettres, comme toutes les jeunes filles de l’époque qui n’étaient pas infirmières, on ne savait pas quoi faire, donc on faisait les Lettres. Puis, fin 1967-début 1968, je suis à Paris pour préparer mon mémoire et je ne suis pas rentrée pendant pratiquement trente ans. Finalement le Valais me manquait, surtout le climat, les montagnes, la nature…. Quant à la liberté, je crois que l’on est libre dans sa tête ou pas; peu importe à vrai dire l’endroit où l’on habite. La liberté, c’est une chose que l’on acquiert ou que l’on n’acquiert pas, mais par soi-même.
– À Paris, qu’est-ce qui vous a amenée à rencontrer les personnes du Mouvement de libération des femmes, du F.H.A.R, et d’autres encore?
– Tout ce qui était conventionnel m’ennuyait. Depuis très jeune, j’ai eu envie de ne pas mener la vie que les gens de ma famille avaient eue. Assez rapidement j’ai eu de la chance. Une amie de ma famille m’a trouvé un stage dans un journal. Un journal bizarre, Vogue magazine, pas exactement ce à quoi j’étais préparée. Néanmoins j’ai appris un métier. C’était une toute petite rédaction composée presque uniquement de femmes qui menaient leurs barques avec une exigence
formidable.
J’ai eu le sentiment que les gens qui faisaient l’histoire, c’était les anonymes. C’était tous ces gens qui bougeaient, qui prenaient des risques, qui avançaient des idées sincères et rigolotes, qui faisaient changer les mentalités
Le jour où j’ai quitté « Vogue », j’ai entendu parler de la vidéo par Jean Genet, qui me dit: «Il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir.» C’était vraiment le départ de la vidéo. Je crois que c’était la deuxième machine qui a été vendue en France. Je me suis alors dit que non seulement j’allais être libre de faire ce que je voulais, mais que j’allais pouvoir donner la parole aux gens qui ne l’avaient pas. Parce que déjà à l’époque – même si la T.V. n’était pas du niveau d’aujourd’hui, elle était bien meilleure – c’était toujours les mêmes que l’on entendait: les chefs, les syndicalistes, les gens connus et reconnus. Et justement, en débarquant pratiquement sur les barricades à mon arrivée à Paris, j’ai eu le sentiment que les gens qui faisaient l’histoire, c’était les anonymes. C’était tous ces gens qui bougeaient, qui prenaient des risques, qui avançaient des idées sincères et rigolotes, qui faisaient changer les mentalités. Et donc ces gens-là, on ne les voyait jamais et on ne les entendait ni à la radio ni à la télé. Et je me suis dit que la vidéo était l’outil rêvé pour ça, parce que ça ne coûtait pas cher…. Je m’y suis donc mise, c’était en 1969, et aujourd’hui je fonctionne exactement avec la même idée de la vidéo.
– C’est-à-dire?
– C’est-à-dire que je m’intéresse toujours aux anonymes, jamais des gens connus. Pour moi, ce qu’il y a de formidable avec l’audiovisuel, c’est l’identification possible à une personne qui dit des choses qu’on n’a pas le courage de dire, auxquelles on pense vraiment ou dont on n’est pas sûr, etc. Cette identification avec le son et l’image fonctionne très bien. Je ne me suis jamais présentée comme artiste. Je me vois davantage comme une écrivaine publique, un relais entre les gens et les spectateurs.
– Donc en 1969, vous créez Vidéo-out, un des premiers groupe vidéo en France.
– Oui, c’était un petit groupe totalement inorganisé. Et on a fonctionné comme cela pendant des années. Parallèlement j’ai rencontré les premières femmes qui avaient fait une cassette vidéo féministe. Elles m’ont invitée à participer à leurs réunions. C’était à peu près six mois après la création du MLF. Pour moi, ce fut une découverte extraordinaire d’entendre toutes ces femmes dire tout ce que je pensais mais que je n’arrivais pas à formuler à l’époque. Des filles extrêmement brillantes, très drôles.
– Justement, ce qui est frappant dans vos documentaires de cette époque, c’est l’humour et la subversion qui prévalaient dans toute action…
– Oui, c’est ce que les gens n’ont jamais compris: toutes les luttes et les mouvements d’opinion qui réussissent – et c’est la grande force des homosexuels – font justement passer l’humour dans les slogans, dans les manifs, dans la vie surtout. Tous les gens qui mènent des luttes sont des gens extrêmement vivants et donc très drôles. Les féministes, à cet égard, ont été injustement caricaturées. Parce que, très objectivement, quand je regarde des archives, quand je relis des livres, les filles étaient à mourir de rire. On décidait que le lendemain on allait faire une manif sur ceci ou cela? Eh bien, on se réunissait, on se mettait autour d’un piano, les filles les plus habiles inventaient les slogans, faisaient les chansons. On s’ouvrait une bouteille de vin rouge et en trois minutes on faisait les affiches. C’était totalement spontané.
– Au défilé du 1er mai, en 1971, des homosexuels dont beaucoup de femmes défilent pour la première fois en tant que tels dans les rues de Paris. Comment vous êtes-vous intéressée à leurs revendications?
– Georges Lapassade (ndr: le mari de Carole Roussopoulos) est venu me demander d’aller avec lui aux Beaux-Arts où tous les mercredis soir les homosexuels hommes et femmes se réunissaient. Je suis partie à une de ces réunions avec lui, enceinte jusqu’aux dents, autant dire que je n’étais pas très bien vue! Là aussi, comme la première fois où je suis rentrée dans l’amphithéâtre des femmes du M.L.F, j’ai trouvé ce lieu de libres paroles incroyable. Très rapidement on m’a demandé si je pouvais donner un coup de main en filmant une manifestation. J’ai donc filmé cette manif du 1er mai 1971, c’était la première fois qu’un groupe s’affichant homosexuel, le F.H.A.R donc, participait à la grande manifestation syndicale du 1er mai qui était une institution française. Et là, cela a été un immense éclat de rire: leurs slogans étaient extrêmement drôles. Il fallait voir la tête des manifestants syndicalistes et des passants! Très rapidement après la manif, un prof de philo m’a demandé de projeter ce petit montage. Ce fut fait et j’ai filmé le débat qui a suivi la projection. Puis j’ai remonté le tout et c’est devenu la vidéo «Le front homosexuel d’action révolutionnaire». Ce qu’il y a d’intéressant d’ailleurs, c’est qu’il a été une des raisons de la scission entre les hommes et les femmes au sein du F.H.A.R., parce que les lesbiennes m’ont accusée d’avoir trop donné la parole aux hommes. En fait, elles se sont aperçues – ce qui était vrai – qu’une fois de plus les femmes avaient beaucoup moins la parole que les hommes; elles ont alors décidé de faire un groupe à part: les gouines rouges.
– Selon vous, qu’est-ce que les lesbiennes ont apporté au mouvement féministe?
– À l’intérieur du MLF, les lesbiennes étaient peut-être les plus radicales et celles qui bougeaient le plus. C’est vrai qu’elles ont poussé le mouvement de libération dans les années 70, 80, 90. Je le dis d’ailleurs dans mon film «Debout», qui raconte ces années de lutte en France et en Suisse, et dans le récent «Qui a peur des amazones?». Je crois que les lesbiennes représentent l’avant-garde au niveau de la réflexion sur le libre choix. Elles incarnent le refus de la séduction des hommes. Mais je connais des hétéros qui ne sont pas dans la séduction des hommes. Personnellement, j’ai plus envie de séduire une femme qu’un homme, même si je vis avec un homme. Cela m’intéresse plus de déclencher une ouverture d’esprit ou quelque chose chez une femme plutôt que chez un homme. Mais il faut faire très attention: autant je suis pour mettre toujours les lesbiennes en avant dans les luttes pour les femmes, autant réduire le féminisme et le MLF aux lesbiennes serait une grave erreur. Ce serait renvoyer dans leur foyer des millions de femmes qui se battent dans leur quotidien, dans leur travail, avec leur enfant et leur mec, etc. Tous les jours elles sont en train de faire l’histoire.
– Le temps de la subversion et de l’humour semble révolu. Vous regrettez cette époque?
– C’est vrai que cet humour, je ne le retrouve plus aujourd’hui. Nulle part. Et c’est une chose qui me manque beaucoup. Vous savez, les années 70 ont été des années très particulières. D’où aussi cette espèce d’émotion ou d’étonnement qu’ont les jeunes quand ils voient des choses de cette époque. Ils nous découvrent drôles et plutôt rigolotes, marrantes, avec des bonnes gueules alors que tout le monde nous croyait moches et je ne sais quoi! Et ils me disent: «Mais quelle chance vous avez eue d’avoir vécu tout cela!»
La violence humoristique, on l’a mise un peu sous le paillasson parce que cela risque de ne plus être très bien compris.
Je crois qu’à un moment donné, la lutte des femmes s’est institutionnalisée. Il y a eu la création de ces ministères, du type Bureau de l’égalité en Suisse, et aujourd’hui les femmes se placent davantage dans une perspective de changer les lois, de travailler sérieusement sur les statistiques. La violence humoristique, on l’a mise un peu sous le paillasson parce que cela risque de ne plus être très bien compris.
– Comment réagissez-vous face à l’image que l’on donne aujourd’hui de la femme dans ces nouveaux jeux de télé réalité tels «Greg le Millionnaire»? N’est-on pas en train de vivre une terrible régression?
– Effectivement, je crois n’avoir jamais vu des choses aussi humiliantes. Et pour nous les féministes, c’est un retour en arrière vraiment très grave. Dans la publicité, à la télévision, je crois qu’on n’a jamais été aussi loin dans l’horreur. Et il semble bien que les débats politiques ne sont pas épargnés. Certaines femmes députées, en France et en Suisse, ou qui ont des fonctions importantes, me racontent qu’elles subissent des ricanements, des allusions et des sous-entendus que les hommes ne s’étaient jusqu’ici pas permis de faire en leur présence. Je pense donc que l’on se dirige vers des années très dures et très violentes, de régression peut-être. Il faut espérer que la génération de femmes qui a pris goût à autre chose va continuer à se battre. Je ne peux pas être totalement pessimiste. Je suis toujours sur le terrain et je vois partout des femmes qui bougent. Il y en a toujours qui ont la pêche!