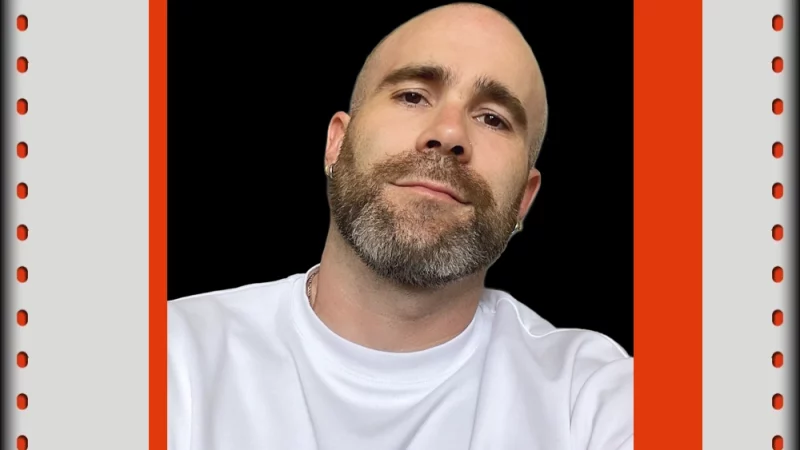Avant que le vent
«Il y a un moment dans la vie des empereurs, qui succède à l’orgueil d’avoir conquis des territoires d’une étendue sans bornes, à la mélancolie et au soulagement de savoir que bientôt il nous faudra renoncer à les connaître et les comprendre ; une sensation dirait-on de vide qui nous prend un soir avec l’odeur des éléphants après la pluie et de la cendre de santal quand elle refroidit dans les brasiers éteints…» Italo Calvino: Les Villes Invisibles
En moi, une sensation de vide parfois, comme une zébrure dans l’âme, à cet endroit précis qui ne supporte aucune agitation. Là où l’esprit cherche à calmer les battements troublés du coeur, où la conscience expose l’inutilité de tout cri, de toute lutte, où seuls le lâcher-prise, l’abandon semblent pouvoir mener à une résolution. Une larme – comme un soupir – en aveu d’impuissance pour traverser cette tristesse qui s’imprime dans ma chair quand les événements me font contempler de loin un être cher que la vie place tout au bord d’une falaise. Je sais alors que rien de ce que je pourrais faire ou dire n’écartera de lui le gouffre qui s’entrouvre à ses pieds. Je ne peux qu’être là, m’approcher doucement et, sans brusquerie aucune, me placer à ses côtés pour contempler le lointain en sa compagnie, laisser ma main trouver la sienne pour imprimer en elle un peu de ma chaleur. Nous sentons tous deux le poison lent qui circule dans la terre alentour et inexorablement approche, à l’instar de cette substance qui à l’automne se mêle à la sève et parcourt la fibre des arbres jusqu’au bout de leurs branches pour en détacher les feuilles avant l’arrivée de l’hiver. Je sais que je ne peux me placer en rempart pour empêcher l’inéluctable, ni même ralentir l’approche de cette vague mais, au présent et au plus calme de mon être, je peux y laisser couler les flux de ma compassion et de mon empathie, pour que de ses plus belles couleur le feuillage s’anime et, flamboyant face au néant, témoigne encore de la beauté de l’être.