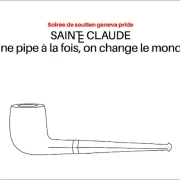François Ozon nous met face à la mort. Sans pathos

Dans «Tout s’est bien passé», le réalisateur français change à nouveau radicalement de registre en s’attaquant au sujet polémique et puni en France du suicide médicalement assisté.
L’éclectisme est une constante chez François Ozon, auteur d’une quarantaine de métrages longs et courts. Soucieux de construire une œuvre en évitant de se répéter, il ne cesse de surprendre en passant du fantastique au musical, de la comédie à la tragédie, du thriller au mélo.
Après Été 85, teen-movie gay romanesque sur fond de pacte délirant, où il donnait libre cours à son appétence pour la subversion des normes sociales, le cinéaste change radicalement de registre et nous plonge dans l’actualité, en proposant Tout s’est bien passé. Comme il l’avait fait en 2018 avec Grâce à Dieu, remarquable fiction sur la pédophilie au sein de l’Église catholique, sortie en plein procès du père Bernard Preynat.
Dans ce drame familial, le réalisateur, pour la quatrième fois en compétition au récent Festival de Cannes dont il est reparti les mains vides, aborde de front le sujet polémique et puni en France du suicide médicalement assisté. Son film, de facture classique, est adapté du roman autobiographique d’Emmanuèle Bernheim (elle-même morte d’un cancer en 2017), qui a aidé son propre père à mourir.
Une course contre la montre
À 85 ans, celui-ci (André Dussollier) est hospitalisé à la suite d’un AVC. Il se réveille dans un lit d’hôpital très diminué, totalement dépendant. Face à une insupportable déchéance, ce riche industriel, collectionneur d’art, bisexuel, qui a trop aimé la vie, ses plaisirs et ses folies pour se voir réduit à un personnage délabré, demande l’assistance de sa fille pour en finir rapidement. Déchirée, elle va finalement accepter. Mais comment s’y prendre en tenant compte des réalités triviales de la vie quotidienne? S’engage alors une véritable course contre la montre.
Tout s’est bien passé, qui interroge au plus profond la question de la fin de vie, doit beaucoup à ses comédiens, dirigés de main de maître par son brillant auteur. Emmanuèle est incarnée par une Sophie Marceau juste et intense qui opère un retour convaincant dans un grand rôle. Charlotte Rampling est comme toujours parfaite en ex-épouse dépressive, à l’image de Grégory Gadebois en ancien amant mystérieux d’André en grande souffrance, et surnommé «grosse merde» par Emmanuèle et sa sœur (Géraldine Pailhas).
Cynisme et second degré
Mais ce qui domine dans le combat de cet homme farouchement déterminé à partir dans la dignité, c’est la formidable prestation d’André Dussollier, personnage par ailleurs un rien curieusement abordé sous l’angle d’un désir homosexuel. Le visage redoutablement transformé et figé à l’aide de prothèses, s’exprimant très difficilement, il se révèle bouleversant dans son immense détresse physique.
Cela ne l’empêche pas de se montrer agaçant, égoïste et capricieux, tout en faisant preuve d’humour et de causticité. Par exemple quand il demande à sa fille comment font les pauvres, en découvrant le prix d’un suicide assisté en Suisse. «Bah, ils attendent la mort», lui répond Emmanuèle… Un cynisme et un second degré à l’image du film de François Ozon et de son plaidoyer pour une liberté de choix. Évitant les écueils du film à sujet, il sait émouvoir sans pathos ni complaisance.