Les non-dits homophobes du «Born this way»

L’orientation sexuelle déterminée par les gènes? Une étude helvético-britannique révèle que cette théorie, perçue a priori comme gay-friendly, conforte aussi les personnes hostiles à l'homosexualité dans leurs préjugés.
Les velléités d’expliquer la raison de l’homosexualité ne datent pas d’hier. Dans le domaine scientifique deux écoles cohabitent: la théorie biologique qui voit une raison génétique à l’orientation sexuelle et celle constructiviste qui soutient une influence du vécu. Mais pas question ici de débattre des causes ou des motifs de l’homosexualité. Ce qui a intéressé les chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) et de la University of Surrey (Royaume-Uni), ce sont les motivations des hétéros à adopter l’une ou l’autre de ces «explications». Et si la théorie biologique est souvent considérée comme «socialement construite comme pro-gay», des raisons plutôt homophobes peuvent pousser les hommes à s’y rallier. Explications avec le professeur Juan Falomir-Pichastor de l’UNIGE.
– Pourquoi traiter ce thème?
Juan Falomir-Pichastor: – Les recherches existantes en psychologie sociale amènent des résultats apparemment contradictoires. D’un côté on observe que la théorie biologique de la sexualité est associée à des attitudes tolérantes envers l’homosexualité et est de plus en plus adoptée dans notre société. D’un autre côté nombre d’études démontrent que les explications biologiques du comportement sont associées à une stigmatisation sociale et des attitudes intolérantes. Nous avons voulu concilier ces deux courants de recherche et montrer que l’adhésion à la théorie biologique peut répondre à d’autres motivations, moins positives envers les homosexuels.
– Qu’a révélé votre étude?
– Les résultats montrent que les hommes hétérosexuels qui ont une vision «traditionnaliste» de la masculinité et des attitudes homophobes adhèrent davantage à la théorie biologique de la sexualité, adhésion encore renforcée dans une société qui prône un traitement égalitaire des minorités sexuelles. Ces dynamiques ne s’observent pas chez les femmes hétérosexuelles.
– Comment cette théorie conforte-t-elle les hommes à tendance homophobe?
– Cette explication leur permet de définir une frontière claire et inébranlable entre eux et les gays. D’autant plus dans une société encline à la tolérance perçue comme menaçant la distinction entre homos et hétéros.
– Pourquoi cela ne se produit-il pas chez les femmes?
– Les femmes ne ressentent pas un tel besoin de démarcation vis-à-vis des homosexuelles. La construction sociale de la féminité ne se fait pas par opposition au masculin, alors que celle de la masculinité se fait par opposition à la féminité et donc à l’homosexualité perçue comme féminine.
– De quelle manière avez-vous mené cette étude?
– Différents indicateurs de motivations à se différencier des gays ont été mesurés chez un échantillon d’hommes hétérosexuels: positionnement par rapport à leur rôle genré traditionnel, perception de la masculinité comme incompatible avec l’homosexualité, attitudes homophobes. Des mesures équivalentes ont été prises chez des femmes. Puis, une moitié était informée que notre société approuvait l’égalité pour les différentes minorités sexuelles et l’autre que notre société était plutôt pour la discrimination. Enfin, tous ont indiqué leur degré d’accord avec la théorie selon laquelle il y a des différences biologiques entre homo et hétérosexuels. Les hommes ayant une forte motivation à se différencier des gays ont été ceux qui adhéraient le plus à la théorie biologique et ce d’autant plus lorsque la norme sociale était égalitaire. A l’inverse, lorsque la norme sociale garantissait une telle différenciation (positive ou négative), leur motivation à se distinguer des homosexuels était satisfaite et leur adhésion aux théories biologiques de la sexualité s’en trouvait réduite…
– Vous soulignez que l’utilisation de la «biologisation» de l’homosexualité diffère en Suisse, en Europe, et aux USA. A quoi est-ce dû?
– En effet, l’adhésion à la théorie biologique et la construction sociale de cette théorie comme étant une théorie pro-gay est plus forte aux USA. Les raisons de ces différences ne sont pour l’instant pas très claires. La «biologisation» peut être associée à différentes motivations qui varient selon les individus et/ou le contexte social. Il faudrait d’abord chercher comment ces motivations sont mobilisées, satisfaites ou menacées dans chaque contexte social ou national, pour ensuite comprendre à quoi sont dues ces différences entre pays.
– Nombre d’homosexuels adhèrent à la théorie biologique. Homophobie intériorisée?
– Peut-être, mais pas nécessairement. Si on se centre sur le lien entre la théorie et l’attribution de responsabilité, le fait que l’homosexualité soit déterminée par la biologie permet de déresponsabiliser les homos de leur «état», de les déculpabiliser. Dans un contexte de stigmatisation cela peut apporter de la tolérance.
– Pour autant, est-ce que cette plus grande tolérance constitue une véritable reconnaissance?
Pas toujours. La question n’est pas de savoir si l’adhésion à la théorie biologique de la sexualité est en elle-même positive ou négative pour les homosexuels, mais pourquoi on y adhère et dans quel but.
– A votre avis, les études sur les «causes» de l’homosexualité sont-elles profitables aux homosexuels ? Y a-t-il besoin de justifications scientifiques pour obtenir les droits?
– Il n’y a pas une «cause» de l’homosexualité à l’origine d’attitudes plus tolérantes. A priori, il n’y a pas besoin d’explications biologiques pour justifier les revendications des minorités sexuelles. Celles-ci devraient bénéficier d’une reconnaissance sociale et d’un cadre juridique approprié indépendamment d’une quelconque cause de leur homosexualité.



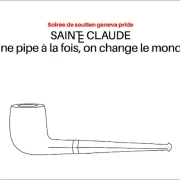





je pense que c’est biologique mais ça fait pas pour autant de moi un homo refoulé désolé, je m’assume pleinement
Si l’homosexualité est d’origine biologique, l’hétérosexualité aussi…
Comment cela se fait-il que ces chercheurs savants, professeurs ne se sont-ils pas posé la question?
Homophobie refoulée?
La question de la construction de la sexualité dans l’espèce humaine est un sujet d’étude à part entière. Trouver des modèles qui permettent de rendre compte de la variété des données (y compris de leur relative fréquence ou rareté) fait partie des objectifs. La difficulté dans ces études est de savoir de quoi l’on parle, et de disposer de modèles adéquats – ils sont souvent animaux, mais pas que : les études sur les jumeaux peuvent être intéressantes.
Cela dit, pour ce qui est de la question des droits, on s’en tape le coquillard. C’est une façon très nord-américaine de lier les questions (droit et biologie), qui ne fonctionne pas très bien chez nous.
Je ne vois guère pourquoi on serait plus gêné de l’étude des comportements sexuels dans l’espèce humaine que des mécanismes, par exemple, de la décision, ou des hormones associées à la lactation. Les soucis en commencent que lorsque ces questions, qui ne doivent trouver de réponse qu’en suivant les mécanismes laborieux et rigoureux de la recherche scientifique, se voient embrigadé pour raconter à peu près nawak en matière de droit et de morale. Un fait naturel ne peut se traduire directement en précepte moral. Erreur de catégorie.