Quelques précisions sur l’affaire Bartholomé Tecia
Une historienne répond à la polémique lancée par un article anonyme, au lendemain de l'inauguration d'une plaque en mémoire d'un étudiant exécuté pour sodomie à Genève, en 1566.
C’est en tant qu’historienne et rédactrice des documents historiques (1) se rapportant à l’affaire Bartholomé Tecia, que j’interviens sur cette page. Ceci afin de discuter l’interprétation qui semble avoir été celle d’un collègue historien dont malheureusement le site LesObservateurs.ch ne nous communique pas le nom dans son article «Bartholomé Tecia: la géométrie des certitudes». M. X (appelons le ainsi) ne semble pas familier avec la paléographie française qui permet de lire (parfois très lentement et laborieusement, il faut l’admettre) un tel dossier. Je reprendrai donc point par point les doutes qu’émet M.X et apporterai quelques corrections et informations légitimées, il me semble, par plusieurs années de travail sur les procès criminels genevois du XVIe siècle.
1° Quelques précisions tout d’abord sur le dossier d’archive sur lequel se base mon travail. Ce dossier (côte AEG PC 1359 1re série) numérisé et accessible sur le site des Archives d’Etat n’est pas un fac-similé (c.a.d une reproduction) mais la numérisation du document original. Le document a été relié au XIXe siècle et l’ordre chronologique des pièces qui le constituent n’a pas été respecté ce qui peut induire en erreur toute personne non familiarisée avec ces sources, sur le déroulement des différentes étapes du procès.
2° L’histoire de Bartholomé Tecia est effectivement connue depuis plusieurs décennies et a été fort bien décrite et discutée par les historiens cités en référence dans le document de contexte historique en lien avec la plaque épigraphique. A ce sujet, je recommande notamment les travaux de M. W. Naphy sur les crimes sexuels au XVIe siècle et plus particulièrement le crime de sodomie (2).
3° Le texte intitulé «nous somme le 10 juin…» est effectivement fictionnel et c’est à ce titre qu’il n’a pas été placé sur le même PDF que le document historique. Cependant, il s’inspire d’indications puisées dans plusieurs sources écrites et iconographiques sur la noyade judiciaire.
4° Concernant les dépositions d’Aggripa d’Aubigné et Emery Garnier, il est bon de se souvenir que les documents des procès ne sont pas un récit objectif des évènements mais des témoignages issus d’une pratique pénale émanant d’une autorité politique. Selon la procédure judiciaire de l’époque, Aggripa d’Aubigné et Emery Garnier sont emprisonnés avant que la décision de poursuivre Bartholomé Tecia ne soit prise. Il faut réaliser que non seulement leur liberté mais aussi leurs vies dépendent de leurs dépositions. En effet, commettre le «crime contre-nature de sodomie» entraine la condamnation à mort mais celui qui le subit est épargné. Selon ce principe, en chargeant Bartholomé Tecia, les déposants sauvent leur vie. Ceci peut être considéré comme une interprétation mais elle se fonde sur le recoupement des informations obtenues lors de la lecture des dépositions et des interrogatoires des protagonistes et de leur relecture en fonction du contexte politique et religieux de l’époque.
5° Bartholomé Tecia a-t-il été torturé? Germain Colladon (3) n’intervient dans cette affaire qu’à titre de juriste à la demande des juges du Petit Conseil et n’est pas le rédacteur de la sentence. Il émet un avis de droit «veu en conseil le dernier [jour] de may 1566» (4). L’avis de droit propose d’obtenir plus d’aveux de la part de Bartholomé Tecia «en le restraignant au crotton»(5) et en le présentant à la torture. Le même jour (dernier jour de mai c.a.d. 31 mai 1566), le Petit Conseil décide «qu’il soit encore suivy à la torture» (6) ce qui selon mon interprétation signifie qu’il a été torturé.
6° Peut-on douter de l’exécution de la sentence? La sentence est prononcée par le Petit Conseil le vendredi 7 juin 1566 et sans doute rédigée par le secrétaire du Petit Conseil le jour même. En effet, la dernière ligne écrite d’une autre main que celle de la sentence précise que «[la sentence est] prononcée le lundy 10 de juin 1566, en ledit jour exécutée». De plus, en lisant jusqu’à la dernière page le dossier du procès numérisé (image 18), on peut lire «Procès contre Bartholomé fils de Bastian Tecia de Villaret en Piedmont, escolier [changement d’écriture et d’encre] le Xe de juing 1566, pour avoir commis le crime de sodomie a este submergé, n° 115». Cette inscription qui conclut le dossier permet ainsi de «classer l’affaire» (pour utiliser une terminologie anachronique au XVIe siècle) n°115 de l’année 1566 (7).
Pour conclure, je préciserai que l’aspect scientifique de la démarche historique implique le doute et le questionnement. Les réponses sont parfois apportées au détour des archives par la découverte de documents qui ont valeur de trésor pour l’historien, mais elles s’enrichissent aussi de la discussion. J’ajouterai que si M. X avait pris la peine de me contacter par mail, je me serais fait un plaisir de partager ces informations, comme je le fais ici, et comme je le fais avec mes collègues historiens ou toute autre personne animée d’une curiosité intellectuelle plutôt que polémique.
—–
Notes
1 Disponibles sur le site de la ville de Genève
2 Accessible à la Bibliothèque de Genève.
3 E-H Kaden, le jurisconsulte Germain Colladon […], 1974.
4 Lisible en haut et à gauche de la première page du document.
5 Et non «à la restraignade du crotton» comme le propose Mme Eugénie Droz dans sa transcription de 1947.
6 Les informations que j’apporte sur la séquence des évènements et des décisions du Petit Conseil peuvent être vérifiées en consultant le Livre des Criminelle des années 1565 et 1566 (côte AEG. Jur. Pen. A4) et en croisant les informations ainsi obtenues avec celles du PC 1359 1ère série. Ce registre est accessible pour consultation aux archives d’Etat de Genève. D’autre part, la torture était appliquée à la prison de l’évêché et non pas à côté de l’Hôtel de Ville (cf. W. Zurbuchen, Prisons de Genève, 1977).
7 Pour de plus amples informations sur le mode de classement des archives criminelles à Genève au XVIe siècle, cf. Sonia Vernhes Rappaz «Criminalité réprimée, criminalité archivée au XVIe siècle à Genève, (1555-1572)», Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, Genève, t. 38, 2008, p. 33-44 et «La mémoire judiciaire d’une république: les archives criminelles à Genève au XVIe siècle» dans M. Porret, V. Fontana, L. Maugué (dir.), Bois, fers et papiers de justice, histoire matérielle du droit de punir, Chêne-Bourg, Georg, 2012, pp. 35-47




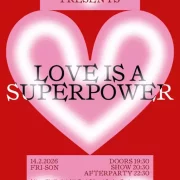




Madame, Veuillez trouver notre réponse à votre article ici http://www.lesobservateurs.ch/2013/07/01/affaire-tecia-la-reponse-de-lhistorienne-responsable/
Bien à vous