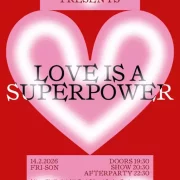Un nouveau souffle
La question du genre est partout. A l’heure où certains constatent un essoufflement des militantismes féministes et LGBT, cette approche dans l’air du temps pourrait bien leur donner un nouvel élan.
«On ne naît pas femme, on le devient», cette célèbre phrase de Simone de Beauvoir nous indique de quoi nous parlons lorsqu’on évoque le genre. Elle signifie notamment que l’assignation à la féminité ou à la masculinité est avant tout une histoire de construction sociale. Le concept du genre ne date certes pas d’aujourd’hui mais depuis quelques temps on remarque un véritable engouement pour cette question. Le cinéma, les séries télévisées, la publicité ou encore les institutions lui font la part belle, une Biennale du genre a été organisée dernièrement à Genève. La dernière pub de la marque H&M s’attaque aux stéréotypes en montrant des femmes qui s’approprient des codes traditionnellement attribués au masculin. Depuis cet automne, l’Université de Genève remet un prix du genre.
La liste des exemples est longue et elle est signe sans doute, qu’une nouvelle lutte est en marche. Un combat qui transcende le simple débat pour l’égalité entre homme et femme ou la tolérance LGBT. Il s’installe à un autre niveau et interroge autant les rapports de pouvoir entre les deux sexes dans un monde à dominance masculine que les rapports entre homosexuels et hétérosexuels dans un monde hétéronormé.
Sur la vague du cinéma
«Cela fait longtemps que la question du genre est dans l’air du temps, affirme Agnès Boulmer, directrice du festival de cinéma Everybody’s perfect. Mais maintenant c’est vraiment concret.» Au cinéma, véritable vitrine du monde, le sujet est très présent. «Je regarde entre 500 et 600 films par année et je me suis rendue compte qu’il y avait tellement de réalisations sur cette question que j’ai créé un classement dédié au genre dans le festival», ajoute Agnès Boulmer. «Les séries américaines montrent de plus en plus de personnages gay ou lesbiens qui sortent de la caricature, pointe Thierry Delessert, historien de l’homosexualité à l’Université de Lausanne. Quand on connaît le puritanisme américain, c’est le signe qu’on a fait une vraie avancée en matière d’acceptation et de représentation.»
Un progrès qui repose, bien entendu, sur le long travail des militants. «Le dynamisme actuel du mouvement LGBT tient notamment à la variété des modes d’action des ses acteurs et à la capacité des militants à faire varier les répertoires de la scène politique à la scène culturelle, souligne Delphine Gardey, historienne et directrice de l’institut des études genre de l’Université de Genève. Ceci explique en partie l’assimilation de ces questions dans la société.» Mais cet activisme tend néanmoins à s’essouffler. «Je remarque une chute du militantisme LGBT, souligne Thierry Delessert. On se croit intégré mais en réalité c’est un leurre. C’est pareil pour le militantisme féministe. Le combat autour du genre pourrait bien leur donner un nouveau souffle».
De l’égalité au genre
La Biennale du genre à Genève participe à cette nouvelle énergie en mettant sur le devant de la scène cette question. «Initialement, l’événement s’appelait la Quinzaine de l’égalité, explique Colette Fry, directrice du bureau de l’égalité. La première édition de 2014 avait connu un grand succès. On a alors décidé de renouveler et de pérenniser l’expérience en l’appelant Biennale du genre.» Cette transition du terme «égalité» vers celui de «genre» n’est certainement pas anodin. Il confirme que nous avons accédé à un autre niveau de débat en même temps que le terme se popularise et se vulgarise.
«La remise en question du genre part du principe que l’égalité est acquise en occident. Le genre c’est la lutte d’après», confirme Agnès Boulmer. Et les avancées académiques en la matière fournissent nombre d’outils à ce combat. Pour Thierry Delessert c’est clair: «La lutte se forme grâce au co-appui entre intellectuels et militants.»
Tardivement
Sur le plan académique, on a été longtemps aveugle à cette question. La recherche s’est considérablement transformée au cours de ces dernières décennies. «Le genre est à l’origine une importation américaine», pointe Delphine Gardey. «Le traitement de cette question dans la sphère francophone a été tardif», poursuit Thierry Delessert.
Aujourd’hui, le genre a sa place à l’université et celle-ci permet de donner une légitimité académique à des travaux à l’origine très disparate. «On n’a jamais eu autant d’étudiants dans ce domaine et on recrute dans toute l’Europe, remarque l’historienne. «L’institutionnalisation est une bonne chose mais le risque est de gommer le potentiel critique et d’entraîner des contre-manipulations», alerte l’historien vaudois. Bien sûr si le genre a mis autant de temps à s’institutionnaliser c’est aussi parce que cette notion a de nombreux détracteurs.
Les «anti-genre»
En statuant que le féminin et le masculin sont des constructions sociales, on bouscule des repères sociaux séculaires. En octobre de cette année, le Pape François avait dénoncé la théorie du genre en clamant que son enseignement dans les manuels scolaires propageait un endoctrinement sournois. Cette accusation a donné du grain à moudre aux «anti-genre» qui craignent une dissolution des identités. «Il y a un vrai désarroi de la part des gens, détaille Thierry Delessert. Ils ont peur que dans 40 ans, nous soyons tous féminin et masculin. Mais ils peinent à comprendre que le genre ne nie pas le biologique. C’est simplement un relativisme du biologique.»
Néanmoins si de nombreuses personnes sont encore très réfractaires à cette approche, il n’en reste pas moins vrai que la nouvelle génération apparaît plus ouverte. «Aujourd’hui de plus en plus de filles n’ont plus envie d’avoir l’air de filles, constate Agnès Boulmer. Elles ont moins peur de s’attaquer à des métiers d’homme et l’inverse est vrai aussi pour les garçons.» Rien d’étonnant puisque cette jeunesse est le fruit d’une sensibilisation médiatique et d’une longue lutte. Celle-ci n’est bien sûr pas finie. «Cette année nous fêtons les 20 ans de la loi sur l’égalité, signale Colette Fry. A l’heure du bilan, on remarque que les choses avancent lentement sur le chemin de l’égalité. Les changements de mentalité prennent du temps». La future génération a donc encore du travail et le riche débat autour du genre lui offre sans doute là, les armes pour son avenir.
Études en pleine évolution
Les études universitaires, bien que parcourues de divergences théoriques, mettent en avant un fait unanimement reconnu : les inégalités entre les hommes et les femmes, les rôles sociaux attribués à chacun, sont traditionnellement justifiés par l’existence d’une supposée «nature féminine» et «nature masculine». Or ces inégalités, ces déterminismes, sont en réalité issus de constructions sociales, de représentations incorporées par les individus via des stéréotypes. Les inégalités ne sont donc pas immuables, ni naturelles, entre les hommes et les femmes. «en étude genre, on peut distinguer quatre temps qui définissent chacune le terme, détaille Thierry Delessert, historien de l’homosexualité à l’Université de Lausanne. D’abord il y a les années 70 aux Etats-Unis où le genre veut dire femme. Puis arrive une pensée binaire qui aborde la question en opposant les hommes aux femmes. ensuite, l’approche est faite sous l’angle des rapports socio-sexués, c’est-à-dire qu’on s’interroge sur la façon dont se fait la construction sociale sur la sexualité. Cet espace permet donc de faire de la place à la question de l’homosexualité. on ne pense pas seulement qu’à la femme hétéro dominée. on réfléchit aussi sur un monde hétérosexué qui impose sa vision d’où découle la construction de la déviance. et maintenant la tendance est au croisement entre le genre, l’ethnie et la classe sociale.»