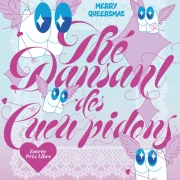Entre élection et malédiction
Pierre-Louis Matthey, Gustave Roud et Edmond-Henri Crisinel, les trois poètes majeurs du pays romand au tournant du siècle dernier, étaient homosexuels. Pourtant capital, cet aspect de leur œuvre émerge à peine d’une longue période d’occultation.
L’aîné, Pierre-Louis Matthey, est le dandy du groupe. Né en 1893, corseté par un milieu puritain (son père est pasteur), il s’émancipe en voyageant en Méditerranée, passe 20 ans d’hédonisme avant de finir sa vie dans la solitude. Le jeune Matthey évoque sans fard son homosexualité par le biais de figures mythologiques. Dans un poème sur Ganymède (l’amant de Jupiter, que le dieu enlève sous la forme d’un aigle), il fait parler un jeune homme dont le corps est harcelé par les désirs de vieillards vampiriques, souffrant d’un véritable esclavage sexuel (Imprudence de Ganymède). Il faudra attendre la publication critique de son œuvre aux éditions Empreintes pour réévaluer une voix qui s’est un peu émoussée: le vieux Matthey reprend ses textes avant sa mort, en 1970, basculant parfois dans la préciosité. Monique Læderach, écrivain féministe récemment disparue, expliquait pourquoi, selon elle, l’homosexualité de Matthey avait façonné son œuvre: «Homosexuel dans une époque dans laquelle on se sentait désespérément maudits de l’être, il a ouvert entre désespoir et culpabilité une fenêtre, certes étroite, mais par laquelle il a crié son désir et sa douleur.». L’homosexualité serait un étouffoir de douleur qui obligerait le poète à façonner sa voix et à la rendre plus forte pour qu’elle émerge du silence plombé où la société veut la contenir.
Improductif et paria
Plus facile d’accès, connue en France grâce à une série de republications, la poésie de Gustave Roud (1897 – 1976) s’inspire du romantisme allemand et cherche les traces du paradis dispersées sur terre. Il les trouve notamment dans le corps des hommes. Roud photographie ses amis paysans, photos qui ont gardé un pouvoir d’évocation intact (le magazine Têtu en publiait des reproductions en juillet 2003). Roud souffre de son homosexualité, mais aussi du fait qu’il est lettré dans un milieu rural – à Carrouge, VD. Il se voit comme un improductif et un paria, à la fois privilégié et maudit, et construit sa position de poète résolument à distance du monde pour l’observer et le transcender.
Edmond-Henri Crisinel, de son côté, vit son homosexualité comme un péché à expier. Dévoré par la culpabilité, il laisse des pages violentes et acérées. Amoureux du sculpteur Jean Clair, il se sent responsable de la mort de son ami en 1933. Coïncidence troublante, dans Alectone, son texte le plus célèbre, il lâche: «pour me sauver, il faudrait un cataclysme ou la mort d’un être cher», phrase déjà écrite en 1918, en marge d’une biographie de Rimbaud. Il connaît une autre passion dévastatrice pour un certain Jean Quentin. Virant à la paranoïa, le poète croit entendre dans un train des soldats murmurer à son encontre «Crisinel-criminel». Interné à plusieurs reprises, le poète rédige un journal à la demande de son médecin. Ce «Journal de la Métairie», non publié à ce jour, est conservé aux archives du Centre de recherche sur les Lettres romandes, à Lausanne. On y lit des aveux sans concession: «aucun rapport sexuel dans ma vie (52 ans bientôt)». Il se suicide peu après, en 1948.
Il y a peu, dans le milieu des lettres romand, le tabou de l’homosexualité était toujours très fort. On n’évoquait pas l’homosexualité de Roud; pire, certains voyaient dans une idylle avec la poétesse Vio Martin la preuve qu’il n’était pas homo, d’autres en faisaient un ermite demeuré chaste devant la tentation des corps de beaux saisonniers italiens. Le détail de sa sexualité importe peu, mais son œuvre charnelle prouve qu’il n’est pas l’être frigide qu’on en a fait. Interrogé sur la question, Daniel Maggetti, professeur à la Chaire de Littérature romande de l’Université de Lausanne, reconnaît un retard dans les «études de genre»: «Le risque de telles analyses est d’être réducteur, mais elles auraient des choses à apporter. Aujourd’hui, c’est par manque d’instruments critiques adéquats que ces œuvres ne sont pas étudiées sous cet aspect, mais ce n’est plus un tabou: cela ne pose plus de problème de dire que ces poètes étaient homosexuels.» Matthey, Roud et même Crisinel ont utilisé leur différence d’orientation sexuelle pour se construire radicalement autres, littérairement parlant: «ils sont en révolte contre une bourgeoisie qui digère et récupère la culture», conclut Daniel Maggetti.
Matthey
«Stupéfié, telle une flamme oubliant de mordre/le bois qu’elle convoitise de toutes ses dents rouges/il va méconnaissant son désir aux cent bouches/dès que rit sa pâture en rut et qu’elle s’offre»
extrait de «Amant de désir», dans Seize à Vingt, in «Poésie Complètes», Cahiers de la Renaissance vaudoise, 1968.
Roud
«Une seconde encore, Aimé, une seule seconde, retarde ce délicieux ensevelissement jusqu’aux lèvres, cet assouvissement parmi l’écume, où le désir se perd dans sa propre plénitude… – puis l’on voit paraître un grand corps repris par l’air, la gorge battante, les yeux fermés, et sous le crin de la lèvre, un long rire de neige qui s’éteint peu à peu.»
extrait de «Bain», dans Essai pour un paradis, L’Age d’Homme, 1997.
Crisinel
«Sache que je renonce à l’amère douceur/D’aimer, d’aimer un beau visage aux yeux immenses»
extrait du poème «Renoncement», in Œuvres, L’Age d’Homme, 1979.